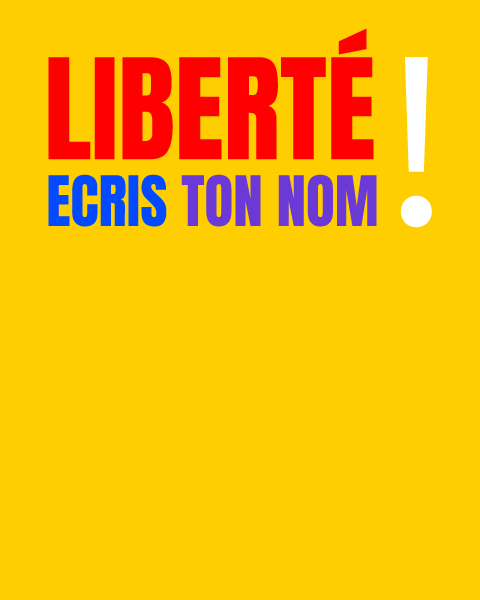Par Candice, Lyna, Alinda, Jorlan, Maélie, Léo, Marie, Charlotte, Joshua, Hugo, Titouan, Arthur, élèves de ML1 du MicroLycée de Caen. Photos : Marie Embark et Alinda Hamo.
«Les Détaché.e.s» met en scène Jean, 35 ans. Il est en prison, condamné à perpétuité. Sa mère lui rend visite au parloir, pour la première fois depuis douze ans. On ne sait pas pour quel crime Jean est condamné. Après une discussion un peu tendue entre les deux personnages, Jean va se replonger dans son passé douloureux et nous y entraîner avec lui.

Qu’est-ce qui vous a amené à créer une pièce sur ce sujet?
Y. Dacosta : J’ai travaillé dans une prison de Cherbourg pour un autre projet. J’y ai rencontré des détenus et j’avais été assez chamboulé de constater que la plupart d’entre eux n’avaient aucune attache familiale. Ils n’avaient pas de parloir et quand ils arrivaient au bout de leur peine, ils n’avaient nulle part où aller, personne à appeler. Ils faisaient une « connerie » exprès, pour revenir en prison, parce que c’était leur seule attache.
Je me suis demandé comment on en arrive à ne plus avoir aucun lien, aucune attache. Alors, j’ai réuni un groupe d’artistes mixte et on a travaillé sur cette question au plateau. La première chose que je leur ai demandée est : qu’est-ce qui vous attache au monde ? Ils ont abordé la question sous l’angle amoureux, familial, professionnel, scientifique… À partir de là, on a improvisé, puis on est retournés en prison pour creuser la question avec les détenus.
Pourquoi avoir choisi ce titreet l’avoir écrit en utilisant l’écriture inclusive ?
Y. Dacosta : C’est l’histoire de Jean, rencontré à la prison de Caen, qui a inspiré le spectacle. Au départ, on pensait se centrer sur son personnage, incarné au plateau par Bryan Chivot. Mais on s’est rendu compte que s’intéresser à Jean uniquement, ce n’était pas juste, qu’il fallait traiter la cellule familiale dans son ensemble. Parce tous sont responsables d’avoir fabriqué ce qui est devenu un «monstre». Toutes et tous sont aussi des détaché.e.s.
« On leur offrait un livret quand on arrivait et on leur disait : « ça, c’est votre espace de liberté ».
Comment les témoignages des détenus ont-ils été recueillis?
Y. Dacosta : Nous avons visité six établissements pénitentiaires, avec à chaque fois un binôme d’artistes. Selon le binôme, on travaillait différemment. Par exemple, à Caen, Stéphanie (co-metteuse en scène et chorégraphe) a travaillé le corps. Dans certaines prisons, l’espace était trop petit ou il n’y avait pas de salle d’activités. On a fait beaucoup d’exercices d’écriture avec les détenus. On leur donnait des exercices, des consignes, comme : «Ecris la lettre que tu aurais aimé recevoir.» Au Havre, un détenu a écrit la lettre qu’il aurait voulu recevoir de ses parents. Puis il a écrit la lettre qu’il aurait adoré leur envoyer, ce qu’il n’avait jamais fait. Sauf qu’il a fini par envoyer cette lettre et il s’est réconcilié avec ses parents.
En arrivant, on leur offrait un livret et on leur disait: «ça, c’est votre espace de liberté». Parce que c’est une vraie question, comment créer de la liberté dans un espace de privation de liberté? Il n’était pas question de repartir avec les livrets, de faire des photocopies puis de leur redonner. Je ne voulais pas être dans un système de pillage. Ça a duré deux semaines, on se retrouvait tous les jours, sauf le week-end, et puis, ils nous donnaient à lire de temps en temps ce qu’ils avaient écrit. Parfois ils le lisaient à voix haute, parfois ils voulaient juste qu’on le lise en privé et parfois ils arrachaient la page: «Tiens, c’est pour ton spectacle.»
« Le spectacle a l’épaisseur de ces après-midis enfermés avec eux dans une petite cellule de neuf mètres carrés. »
Le spectacle est né de ces rencontres. Il a l’épaisseur de ces après-midis enfermés avec eux dans une petite cellule de neuf mètres carrés. Cette expérience a imprégné les acteurs, permis des improvisations au plateau et inspiré Manon (co-metteuse en scène et auteure) à l’écriture.

Comment s’est passée la rencontre avec Jean?
Y. Dacosta : La prison de Caen a la particularité d’être un centre pénitentiaire pour criminels sexuels, qui ont de longues peines et ont déjà trente ans de prison ou plus. Ils sont suffisamment brillants et intelligents pour avoir eu de l’emprise sur leur victime. Ils sont profs, avocats ou pilotes de ligne ; ils viennent de tous les milieux sociaux, y compris les plus favorisés. Et on a aussi des détraqués psychiques, qui sont sous médocs et qui devraient, à mon avis, être en hôpital psychiatrique.
« Le spectacle est né de notre droit à l’empathie. »
Jean était très gentil et avenant: «c’est super ce qu’on fait avec vous, merci…». On avait de l’empathie. On passe deux semaines avec ces mecs et on s’amuse, on rigole, on fait un goûter ensemble tous les jours, on parle de choses et d’autres, on crée des liens. Et puis à la fin de ces deux semaines, on a su qui était Jean, et ce qu’il avait fait. Et ça nous a énormément bouleversé. Parce que tout à coup, on avait accès au monstre, et à la monstruosité de ce qu’il avait fait. Jean est quelqu’un de tristement célèbre, on a trouvé des articles de presse et des émissions sur lui. Avec nous, il avait fait part, à demi-mots, des violences et des cruautés familiales qu’il avait subies. Peut-être aurait-il pu devenir un homme bon? Nous étions tiraillés entre l’empathie et l’horreur. Le spectacle est né de ça, de notre droit à l’empathie.
Pourquoi êtes-vous trois metteurs en scène pour cette création?
Y. Dacosta : Au départ, j’étais seul à la mise en scène, mais je m’étais entouré d’artistes qui savent aussi écrire, comme Samaël, qui est à la fois et éclairagiste et poète, Manon, comédienne et autrice, Stéphanie, chorégraphe et autrice… Tout le monde écrivait, tout le monde lisait ses textes, mêmes ceux qui ne sont pas auteurs. Petit à petit, Manon a commencé à rédiger la première scène du spectacle, celle du parloir, puis une deuxième, une troisième, etc. Manon a une écriture si particulière, très laconique, incisive, avec beaucoup de silences qu’on pouvait difficilement la conjuguer avec d’autres. Donc on a décidé que c’est elle qui écrirait la pièce. Et comme elle avait aussi une idée très précise des personnages, il fallait qu’en plus du texte, elle donne aux acteurs les directions. Stéphanie, de son côté, a pris une grande place au niveau du corps. On ne pouvait pas juste dire: «t’es chorégraphe, tu fais tes chorés et après tu repars.»
Même si c’était nouveau pour moi, je n’ai eu aucun problème à dire: «On a trois regards qui se croisent; on est trois à mettre en scène». On a mis du temps à trouver notre méthode de travail. Il fallait débriefer sur tout, tout mettre en commun, pour être sûrs qu’on voulait tous raconter la même chose.
Sur scène, il y a deux praticables et une machine à laver. Pourquoi?
Y. Dacosta : J’aimais bien l’idée du côté abstrait des praticables, c’est-à-dire qu’on ne donne pas de repère social sur cette famille. De la même manière qu’en prison, les auteurs de violences sexuelles viennent de tous les milieux. Le film «Dogville» m’a inspiré pour le décor : la maison est matérialisée au sol par des bandes blanches.
Pareil pour la machine à laver, qui est abstraite. On a demandé à des détenus des souvenirs d’enfance, et l’un d’eux nous a raconté : « Je suis assis sur la lessiveuse et je regarde ma mère se maquiller » et on comprenait que sa mère devait se maquiller le soir, avant que le père ne rentre, ce qui était pour nous le signe d’une grande violence. On a improvisé à partir de cette image et de la symbolique de la machine à laver : le domaine de la femme, le giron de la mère. Dans la scène finale, quand Jean sort de la machine à laver, on a l’impression que c’est un accouchement. On parle des « détachés » et la machine à laver retire les taches. Est-ce que la prison détache ?

Pensez-vous que la société manque d’humanité envers les personnes incarcérées?
Y. Dacosta : Certains délinquants, en sortant de prison, deviennent plus violents qu’ils ne l’étaient avant. Ces prisonniers vivent parfois à six dans neuf mètres carrés, avec trois lits superposés et un cabinet à la vue de tous. En maison d’arrêt, les détenus ont une heure de sortie par jour dans une petite cour où ils marchent «en carré»… Le bruit est permanent, impossible de dormir, de se reposer. C’est un traitement que je qualifie d’inhumain. Très peu s’en sortent après la prison.
Des choses sont en train de changer malgré tout : l’accès à l’école, à la culture, le bracelet électronique… tout cela pourrait sûrement rendre la détention meilleure. Mais ce n’est pas une solution pour tous les détenus. Certains sont malades, ont besoin de soins et la prison manque de psychologues. Prenez le cas des criminels sexuels : comment sait-on qu’ils sont guéris ?
De quoi parlera votre prochaine pièce?
Y. Dacosta : Je voudrais travailler sur la question des classes sociales et de la réussite ; interroger des personnes de classes différentes. Ça veut dire quoi « réussir » ? Est-ce qu’on a tous les mêmes chances ? Est-ce que la réussite est une question de prestige, d’argent ? Je m’intéresse aussi à ceux qui changent de classe sociale, ceux que l’on appelle les « transclasses ».