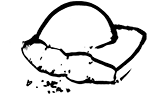Quand les fours se sont arrêtés, un matin de 2013, les salariés de l’usine « Jeannette », à Caen, ont pensé que tout était cuit : la biscuiterie normande était donc promise au même destin que des centaines d’usines en France. Mais dans cette vieille maison de 166 ans, une poignée de femmes en a décidé autrement. Armées de leurs petits gâteaux, Rosa et ses collègues ont mené une inoubliable guerre d’usure contre le déclin industriel.
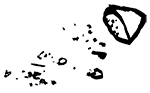
«Tenue correcte » était-il écrit dans le courrier. Rosa a gardé le secret de sa toilette, jusqu’à ce mardi où elle a retrouvé les copines sur le parking de l’atelier, aux portes de Caen. La pluie de la veille a laissé place à un temps clair. Il est très tôt, mais Rosa a l’habitude des réveils au milieu de la nuit, du temps de l’ancienne biscuiterie.
Ce matin pourtant, l’ouvrière de cinquante ans ne vient pas travailler. Elle a troqué le bonnet des « Jeannette » que leur a offert le nouveau patron contre un petit béret élégant. Elle a relâché ses cheveux et s’est maquillée. Apprêtées comme pour un jour de fête, rayonnantes, elle et ses collègues sont montées dans le bus qui les mène à l’Assemblée nationale.
Ce 16 février 2016, elles ont rendez-vous avec les députés. Elles vont signer un contrat pour vendre leurs madeleines à la buvette des parlementaires. Surtout, elles sont venues livrer leur histoire. Celle d’une longue résistance pour sauver leurs emplois et une marque française vieille de 166 ans. « Vous êtes des héroïnes », leur avait dit Franck Mérouze, le secrétaire de l’union locale CGT, après 11 mois d’occupation d’usine.
« Nous sommes des princesses », avait répondu Rosa, la voix tremblante d’émotion, devant le tribunal de commerce de Caen qui venait de leur attribuer un repreneur. « Des princesses qui se sont sauvées avec leur prince charmant. »

Rosa Do Santos
Aînée de sept enfants, fille d’immigrés portugais, Rosa Do Santos entre à 16 ans chez Jeannette, en 1972. La biscuiterie, championne nationale sur le marché de la « pâte jaune », produit en une année près de 7 000 tonnes de pâtisseries. Rosa est l’une des 300 salariés, répartis sur deux sites. Elle travaille au « fruitage », la dernière opération qui n’a pas encore été automatisée au sein de cette grande usine de production. « Il fallait garnir les petites madeleines de fruits confits et d’amandes effilées », raconte-t-elle en mêlant machinalement un geste mille fois répété à la parole.
“Nous étions tous en train de travailler et tout à coup, ça s’est coupé. C’était la fin.”
À l’époque, Rosa parle mal français, les copines l’aident. Elles ont toutes le même âge. Dans le vacarme assourdissant des chaînes de production, elles partagent leurs secrets et leurs rêves de jeunes filles. Elles fêteront ensuite les mariages et les naissances. « C’était comme une deuxième famille », se souvient Rosa, attendrie. Une famille au sein de laquelle elle découvre la culture française et la langue, qu’elle colore encore aujourd’hui de son accent et d’expressions fantaisistes.

Les filles encaissent les coups durs et se serrent les coudes. En décembre 2013, l’entreprise ne compte plus que 37 salariés. Le bâtiment et les machines sont à bout. En quelques jours, à la veille de Noël, tout s’arrête brusquement. « On a fini le stock d’œufs et les fours ont cessé de tourner », peine à raconter Rosa. Malgré les signes annonciateurs, elle ne veut pas y croire. Les services de l’État sont formels : « Jeannette, c’est terminé ». Rosa et ses copines ont passé la cinquantaine.
“Tant qu’on était dans l’usine, on n’avait pas l’impression d’être au chômage.”
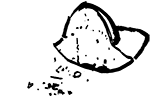
C’est Françoise Bacon, la déléguée CGT de l’usine, qui a eu l’idée. Quand elle apprend, dans le canard local, que la vente aux enchères des machines aura lieu le 20 février 2014, elle appelle la centrale syndicale. Le tribunal a prononcé la liquidation de la biscuiterie un mois plus tôt. Les salariées viennent de recevoir leur lettre de licenciement.
Franck Mérouze, chef de l’union locale, se souvient du premier contact. « Je leur ai demandé ce qu’elles voulaient : toucher une prime ou conserver leur emploi ? Toutes ont répondu qu’elle voulaient travailler. Elles m’ont demandé si elles pouvaient occuper l’usine. J’ai dit : bien sûr qu’on va l’occuper cette usine ! »
Les filles sont rentrées dans la nuit. Rosa se souvient de leur infiltration discrète. « On connaissait tellement les lieux, qu’on auraient pu y entrer les yeux fermés », semble-t-elle justifier. Quand le commissaire-priseur et la dizaine d’acheteurs arrivent au petit matin, « avec leurs gros camions aux plaques d’immatriculation étrangères », ils ne peuvent pénétrer dans l’enceinte. Le grand portail est cadenassé. L’occupation des « Jeannette » a commencé. Personne ne se doute alors que le siège durera si longtemps.
La décision d’occuper l’usine sonne comme l’ultime révolte. Les « Jeannette » ont réagi instinctivement, pour sauver leur outil de travail. « Qu’est ce qu’on aurait fait à rester chez nous ?, demande Rosa. Tant qu’on était dans les murs, on n’avait pas l’impression d’être au chômage. »
Petit à petit, la mobilisation s’organise. À l’extérieur, les murs en pierre sont placardés d’affiches, de slogans peints et de tracts laminés par la pluie et le vent. « Prime de misère, blocage de l’usine », « Non au pillage industriel » ont écrit les salariés. Au-dessus du grand portail, un rétroviseur a été installé pour vérifier qui sonne à la porte et une bouteille de gaz trône symboliquement.
À l’intérieur, il n’y a plus d’odeur de biscuits chauds, ni de graisse de machine. Plus de bruit si ce n’est le murmure d’une télévision. Un grand panneau d’affichage sert à planifier les tours de garde. Vingt et un salariés se relaient jour et nuit, « les femmes seulement le jour », précise Rosa. Une cuisine sommaire a été installée, une grande table pour manger et des lits de camp pour se reposer. Le site est nettoyé tous les jours, car « l’usine doit être belle le jour où le repreneur viendra ». La menace d’expulsion est permanente.
Franck Mérouze
Quand le moral des ouvrières flanche, la détermination de Franck Mérouze chasse le doute. Le bureau de l’union locale de la CGT est à deux pas de l’usine, et le syndicaliste, un homme de la génération des « Jeannette », est toujours disponible.