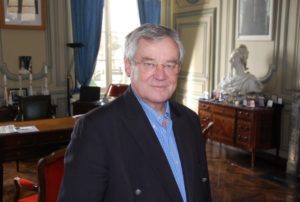Jean-Claude Lenoir a été maire, député, sénateur. Il est aujourd’hui président de la communauté de communes du Pays de Mortagne au Perche. Pour lui, il est important de peser ses mots quand on est un élu, et de favoriser ainsi la modération.
Est ce que vous avez été amené à suivre l’avis ou les décisions de votre parti alors que vous aviez un autre avis ?
Si on est dans la majorité, on soutient le gouvernement. C’est une question de ligne politique. De temps en temps, il y a des votes à l’assemblée où le gouvernement demande le soutien de l’assemblée. Si on ne le soutient pas alors qu’on est dans la majorité, cela pose problème. En revanche, sur de nombreux textes de loi, la liberté de l’élu est totale. Nous ne sommes pas des machines à voter. Ce n’est pas la peine d’être 400/500 dans l’hémicycle si on nous dit comment voter. Il y a beaucoup de débats sur des questions éthiques, par exemple : sur les questions d’union civile quand il y a eu le PACS, le mariage pour tous, etc. Il y a eu des débats qui étaient personnels. La loi interdisant la peine de mort a été votée à l’assemblée nationale. Quand on l’a intégrée dans la Constitution, le débat est revenu. J’avais des collègues de mon groupe politique qui étaient contre moi, puisqu’ils étaient pour la peine de mort. Pendant mon mandat dans l’opposition, il y avait des dispositions proposées par le gouvernement que je trouvais tout à fait logiques, intéressantes. J’ai toujours été attaché à ma liberté.
Y-a-t’il des choses que l’on ne peut pas dire en politique ? Pourquoi?
Je pense qu’il faut peser ses mots. Mais il y a des gens qui s’expriment de façon plus « cash », plus directe. On le remarque bien dans les débats politiques aujourd’hui. Quand j’étais élève à Bignon, un instituteur nous disait toujours qu’il faut tourner la langue dans sa bouche plusieurs fois avant de parler. Quand on est élu, maire, parlementaire, on doit favoriser la modération. On est dans une société avec de grandes tensions. On voit bien qu’il y a une agressivité permanente, une forme de violence. Il y a des mots qui sont prononcés assez facilement. Les gens sont excités. Parfois, j’ai perdu mon sang froid : vous êtes mal luné le matin, vous vous dites: » celui là commence à m’ennuyer.. ». Les élus doivent être pédagogues, il faut expliquer… Les gens sont un peu perdus. Ils se demandent parfois : pourquoi telle situation, pourquoi telle décision ? On n’est pas responsable de tout, mais on peut donner des explications. Aujourd’hui, on a accès à toute sorte de sources d’information. On en a tellement qu’on n’arrive plus du tout à faire le tri. Quelles sont les bonnes et les mauvaises informations ? Je pense qu’il faut réussir à faire la part des choses.
Quand on est un homme politique, comment éviter le sexisme envers les femmes politiques ?
C’est un vrai sujet ! Quand j’étais jeune, j’ai vu beaucoup de sexisme. Je mesure aujourd’hui combien l’égalité homme/femme n’était pas assurée. Un certain regard était porté par les hommes sur les femmes… Pendant longtemps, elles n’avaient pas les mêmes droits politiques, professionnels, et dans la vie quotidienne. Ma mère a attendu plus de quarante ans avant de pouvoir voter. Dans la vie politique, très peu de femmes avaient accès aux fonctions parlementaires ou même de conseillère municipale. La première fois où j’ai été élu au conseil municipal de Mortagne, sur 23 conseillers, seulement trois étaient des femmes. Une revendication a été partagée par l’ensemble des responsables des élus pour que la place des femmes soit reconnue. Mais ça n’a pas suffi. Des résultats ont été obtenus lorsque la loi a obligé ce qu’on appelle la parité. Aujourd’hui, un député sur quatre est une femme. Après la seconde guerre mondiale, trois femmes étaient ministres mais elles ne pouvaient pas voter comme électeur. L’état d’esprit est peu à peu en train de changer.
Solal, Léa et Yviane, Photo : Emilie Jouvin/Publihebdos - journal Le Perche