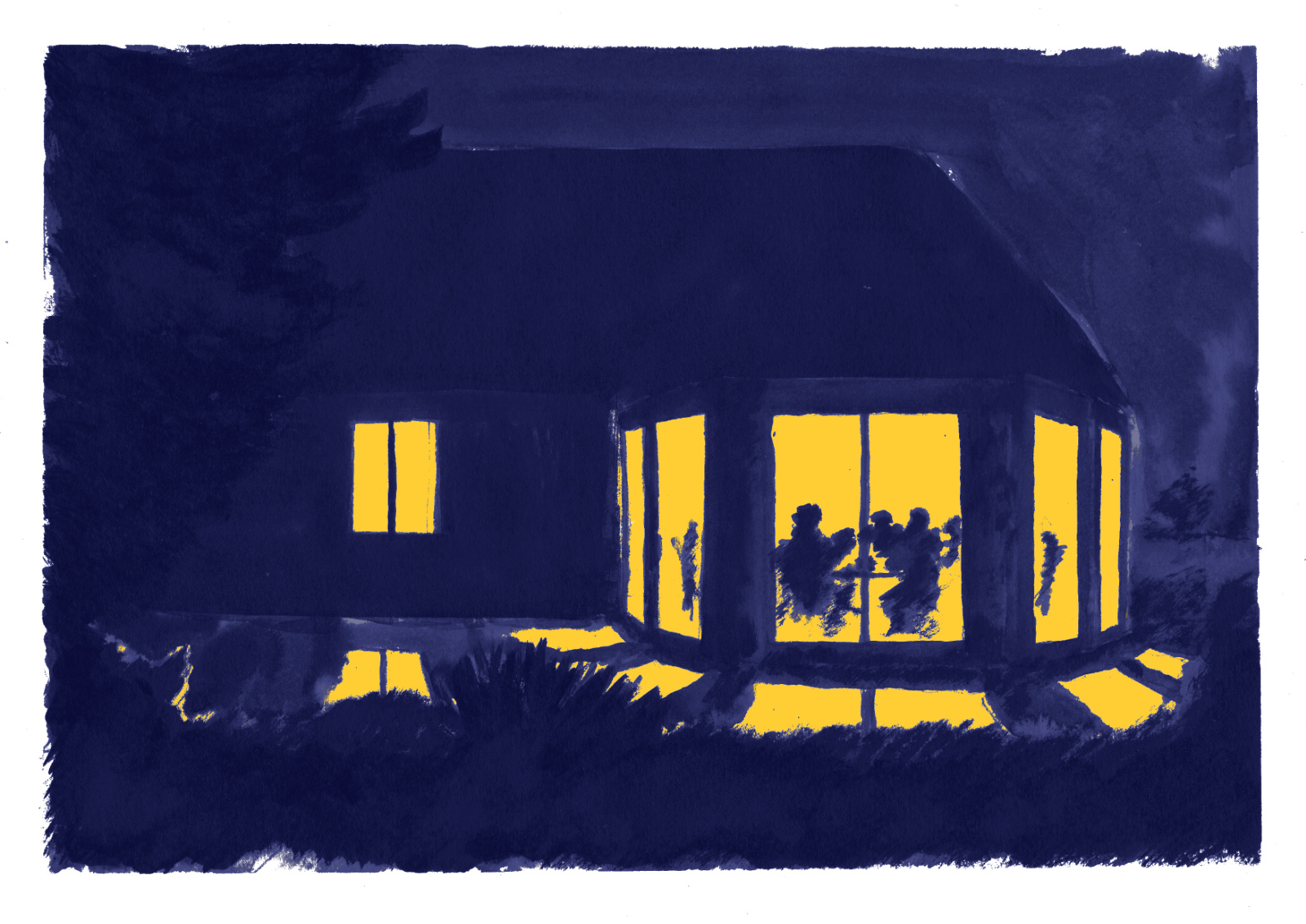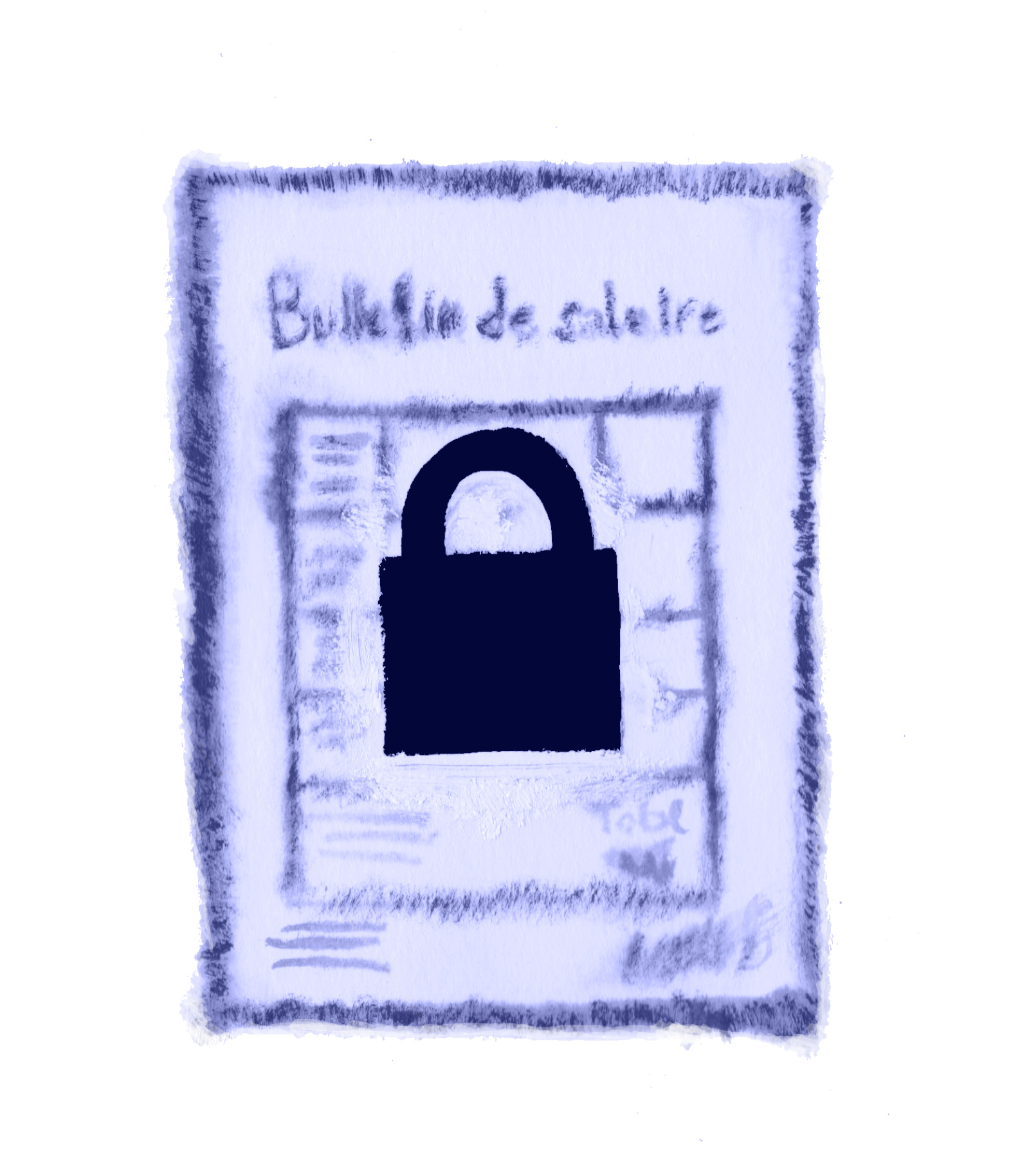À Vire, dans le Calvados, des migrants sous le coup d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) espèrent une régularisation de leur situation. Des recours juridiques leur sont encore accessibles. Pour les accompagner dans ces démarches, les accueillir ou simplement partager des moments de convivialité, des associations locales et des citoyens se mobilisent. Un récit de Caroline Mignien, illustré par Nikita Hyzy.
Au bout d’une allée discrète, dans un village du bassin virois, une maison abrite une famille de migrants menacée d’expulsion depuis plusieurs années. Arrivée en France en 2022 pour fuir un conflit familial religieux et des violences physiques, cette famille, dont la nationalité ne peut être dévoilée par souci d’anonymat, a trouvé refuge auprès d’un couple de retraités.
Pierre et Odile* avaient aménagé leur sous-sol il y a quelques années, avec l’idée d’ouvrir ponctuellement leur porte à des personnes sans-abris, des passants ou des marcheurs. C’est à travers la communauté chrétienne qu’ils ont rencontré la famille de migrants aujourd’hui installée dans le sous-sol lumineux, éclairé par une grande baie vitrée. À droite de l’entrée, une imposante statue de la vierge Marie accueille le visiteur. L’endroit est décoré de photos de famille et de bibelots en porcelaine posés sur une grande étagère, donnant au lieu une atmosphère chaleureuse et personnalisée.

« Tout le monde connait le pays qui aide les migrants. »
Ana*, l’une des enfants de la famille accueillie, aujourd’hui âgée de 18 ans, n’avait que 15 ans lorsqu’elle a quitté son pays avec ses parents et son frère. Ils souhaitaient venir en France car « tout le monde connaît le pays qui aide les migrants », raconte-t-elle pour expliquer leur choix. L’adaptation à l’école n’a pas été facile. Elle ne parlait pas français et les autres élèves ne parlaient pas anglais. Aujourd’hui, c’est différent. Ana* a son groupe d’amis, maîtrise le français, parle même plusieurs langues, et ambitionne de devenir interprète. D’ici trois ans, la famille espère régulariser sa situation, encouragée par le fait que les parents travaillent désormais. « Ce sera plus facile », estime-t-elle avant de conclure : « On souhaite rester en France. On est bien ici ».
Un réseau d’associations
À leur arrivée en France, les migrants qui déposent une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) sont orientés par l’Etat vers un Centre d’accueil des demandeurs d’asile (Cada) pour la durée de la procédure, selon les places disponibles. À Vire, cette mission est assurée par l’Association des Amis de Jean Bosco (AAJB), qui met en œuvre un accompagnement strictement encadré garantissant des conditions matérielles d’accueil prévues par la loi française. L’AAJB de Vire s’appuie sur un réseau d’associations pour offrir aux migrants un rythme de vie, favoriser leur intégration sociale et les accompagner dans l’apprentissage du français.
Amnesty International, l’Avar pour l’apprentissage du français (lire l’article écrit par des lycéens), la MJC, le théâtre du Préau et le Secours Catholique pour les moments conviviaux, culturels et le lien social : la famille de migrants hébergée au sous-sol a pu compter sur l’aide de plusieurs associations. Et sur le soutien de nombreux citoyens engagés dans ces structures, comme Thérèse, affectueusement surnommée « maman Thérèse », par Yasmine* la mère de famille.
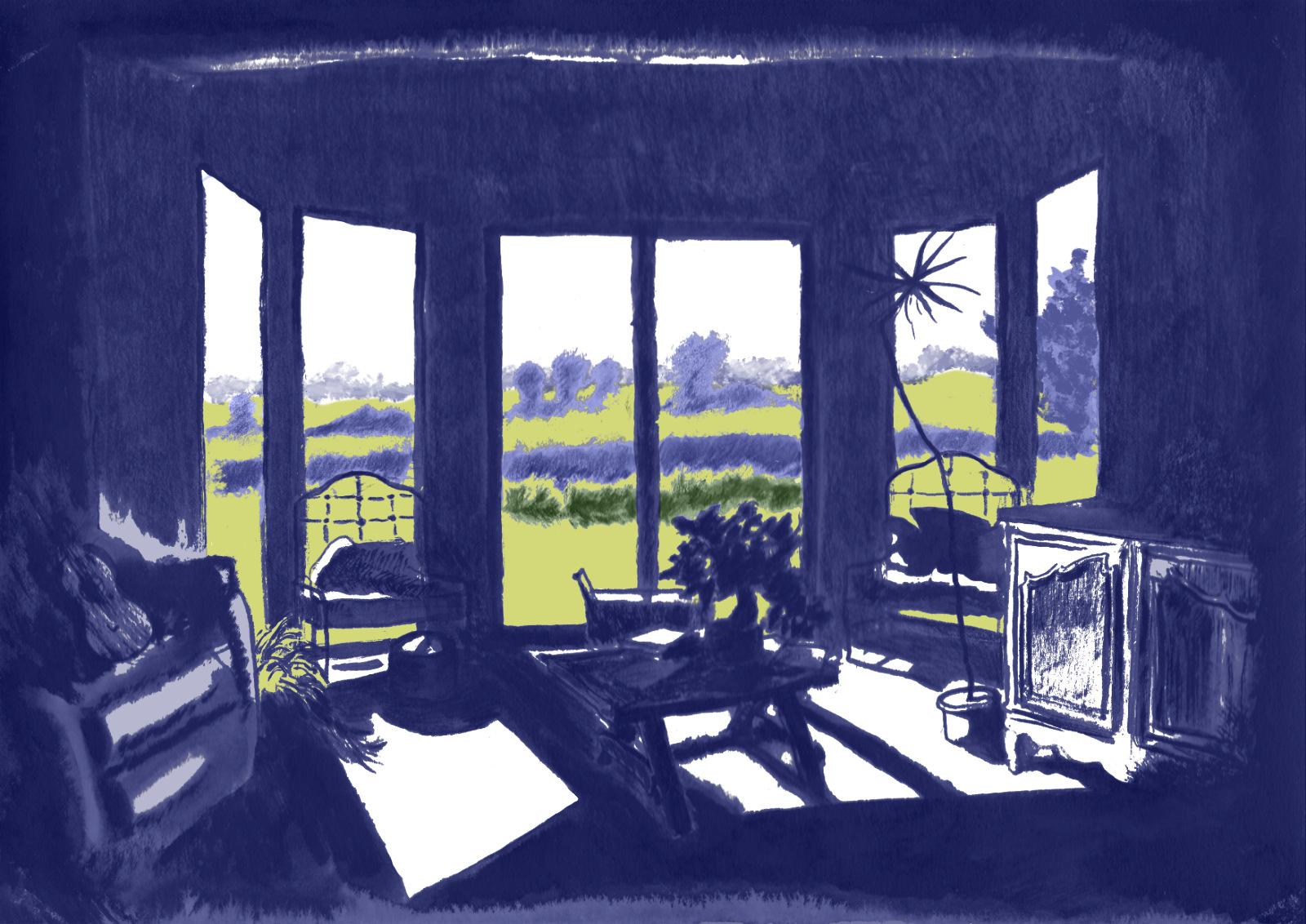
Membre de l’Association viroise de soutien aux personnes migrantes (collectif SAM), Thérèse leur a fourni l’essentiel pour s’installer – couvertures, vêtements, vaisselles et autres objets du quotidien – et a mobilisé des familles locales pour proposer aux parents du travail rémunéré et déclaré.
Collectif SAM : aider les migrants à exercer leurs droits
Créé en février 2023 de la volonté de quelques bénévoles, et en réaction à l’OQTF délivrée à une famille originaire du Haut-Karabakh, le collectif SAM œuvre pour venir en aide aux migrants en situation de grande précarité.
Dans un contexte juridique complexe, les membres du collectif s’engagent pour un accompagnement humain et pour prodiguer des conseils juridiques aux migrants déboutés du droit d’asile, alors qu’ils n’ont parfois pas pu aller au bout des recours possibles. « Notre rôle est d’aider les migrants à exercer leurs droits en toute dignité », explique l’une des membres. Lorsque les personnes voient leur demande d’asile rejetée par l’Ofpra, un recours est possible auprès de la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) qui confirme ou non cette décision. C’est ensuite que le collectif intervient, en collaboration avec les éducatrices du Cada et les autres associations viroises.

Cependant, lorsqu’un migrant est finalement débouté, il reçoit de la préfecture une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), dont le délai d’exécution est de trois ans, et perd le droit d’être accompagné par le dispositif du Cada. Il se retrouve alors sans aides financières pour subvenir à ses besoins, et sans logement.
« C’est particulièrement inhumain de voir une personne, jusqu’à maintenant hébergée (même sous condition), être mise dehors du jour au lendemain, sans solution » déplorent Gérald et Rosine Leverrier, habitants retraités et militants de Vire. Gérald, ancien travailleur social auprès des sans domicile fixe (SDF) connait bien la problématique du logement des plus démunis. Sa femme Rosine, enseignante à la retraite, est sensible au sort des enfants migrants qui ont l’obligation, en France, d’être scolarisés. Cette indignation les a d’ailleurs encouragés à accueillir plusieurs fois des migrants chez eux. Le collectif SAM est aussi né de cette indignation.
« Un caillou dans la chaussure de l’État »
Afin de payer le loyer d’un hébergement d’urgence mis à disposition de migrants déboutés et permettre une aide financière ponctuelle, l’association dépense 1000 euros par mois. L’hébergement permet de loger une famille de trois personnes. « La moitié de nos ressources provient des dons des adhérents » expliquent-ils.
Depuis octobre 2024, le collectif est reconnu d’intérêt général, ce qui permet aux donateurs de bénéficier d’exonérations fiscales, pouvant faciliter le don. Une reconnaissance qui légitime leur action. Cependant, l’association reste lucide : venir en aide à une personne en situation irrégulière constitue un délit en France, mais les auteurs ne seront pas poursuivis s’ils poursuivent un but humanitaire (lien Legifrance). « Pas sûr qu’au niveau national, on ait envie qu’il y ait des gens comme nous. On diffuse l’idée que l’État ne remplit pas son rôle humanitaire et d’accueil et en plus, on aide, on accompagne les migrants dans leurs démarches avec les avocats. Nous sommes un petit caillou dans la chaussure de l’État », sourit un membre. Le collectif SAM assure l’accompagnement d’une quinzaine de migrants.
« Hypocrisie de l’État »
Le combat pour obtenir des papiers est semé d’embûches pour les exilés. Les membres du collectif SAM dénoncent une « hypocrisie de l’État ». Un migrant a la possibilité d’être régularisé par le travail, mais pour cela, il doit présenter huit bulletins de salaire en deux ans, alors même qu’il est officiellement interdit d’emploi sans titre de séjour. Une situation absurde qui favorise le travail dissimulé, mais qui permet tout de même aux migrants de pouvoir vivre, de gagner en autonomie et de bénéficier à terme d’une reconnaissance par le travail.
Des boat people aux Ukrainiens
Dans les années 80-90, plusieurs familles asiatiques, notamment du Cambodge, ont été accueillis, grâce à une volonté communale, pour fuir la répression dans leurs pays. Des communautés religieuses se sont mobilisées à l’époque pour les accompagner. Plus récemment, en février 2025, la mairie de Vire a également accueilli une cinquantaine d’Ukrainiens dans la ville et son bassin.
« Il y a vingt ans, il n’y avait qu’un seul élève de couleur dans tout le collège, aujourd’hui fermé », se souvient une bénévole du collectif SAM, ancienne enseignante. Aujourd’hui, face à une présence accrue des migrants, des résistances persistent auprès des habitants : faible mobilisation citoyenne, tensions politiques liées à l’immigration, poussée du Rassemblement National, notamment constatée lors des dernières élections législatives. Un souvenir marquant de Rosine illustre ce climat : elle se souvient d’une intervention de gendarmes pour expulser une famille d’élèves il y a plus de vingt ans. Les parents de l’école s’étaient fortement mobilisés à l’époque pour éviter leur expulsion. Aujourd’hui, malgré quelques changements, « l’indifférence reste forte et je me questionne sur la mobilisation qui aurait lieu aujourd’hui si cela se reproduisait ».
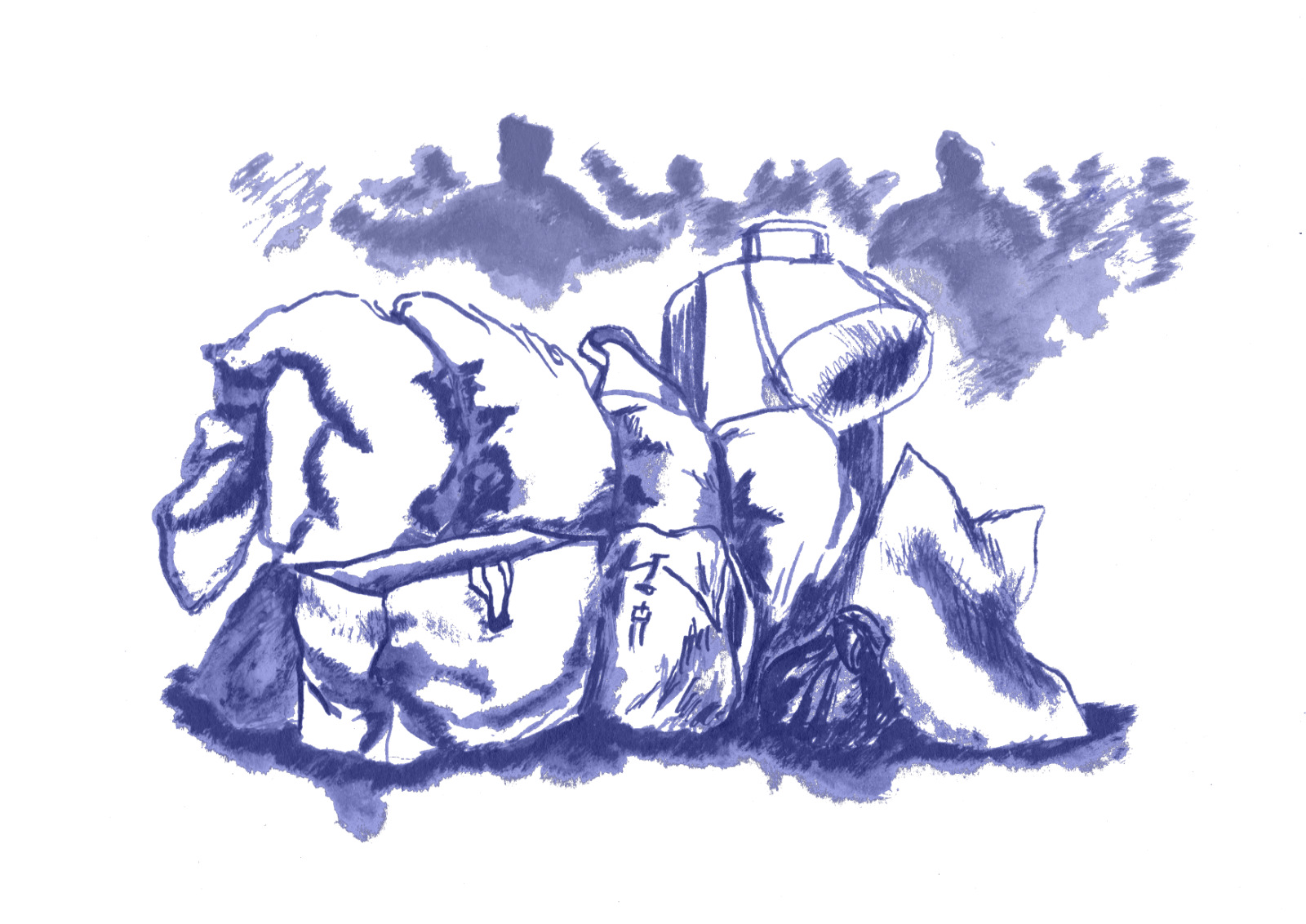
Face à ces tensions, le collectif SAM continue de défendre des valeurs universelles de solidarité et de fraternité. « Nous avons la chance de vivre en paix en France. Eux fuient la guerre, les persécutions, les famines », rappelle un membre, lui-même descendant de migrants originaires d’Europe de l’Est. Pour les bénévoles, l’immigration est un phénomène humain naturel et ancien, amplifié aujourd’hui par les inégalités mondiales et les conflits.
Malgré ses moyens limités, le collectif SAM joue un rôle essentiel auprès des migrants. Avec ses partenaires associatifs, il recrée du lien social, organise des moments de convivialité et remet de l’espoir au cœur de vies bouleversées et déracinées.
« Nous avons sans doute autant appris que lui de cette rencontre. »
À Vire, Gérald et Rosine Leverrier incarnent une solidarité discrète mais déterminée. C’est par leur contact avec le Cada (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile) local qu’ils rencontrent, en 2022, Issa*, un étudiant migrant qu’ils accueilleront chez eux. « C’était notre première rencontre avec une personne exilée. Il n’était pas sous OQTF, donc la situation était moins tendue. » Quelques mois plus tard, ils accueillent chez eux Tamba*, un jeune africain, sous le coup d’une OQTF. Hébergé durant deux mois, il parviendra finalement à obtenir ses papiers après un passage à Paris pour y travailler. Aujourd’hui, Tamba habite Caen et travaille dans le bâtiment.
Avec Tamba, la cohabitation était naturelle : bricolages du bois (la passion de Gérald), balades à vélo, repas partagés, implication dans les tâches ménagères… Un quotidien simple qui laisse des souvenirs marquants. « C’était deux mois relativement chouettes. Nous avons sans doute autant appris que lui de cette rencontre », confie Gérald.
Pour eux, la religion n’est pas le moteur de leur solidarité. Il s’agit davantage d’un engagement envers les plus vulnérables. « Tout au plus, on pourrait imaginer que l’on se sent coupable des relations que peut avoir notre civilisation riche et occidentale auprès des populations qui arrivent ici », expliquent-ils.

Combattre ses propres préjugés
Aujourd’hui, Gérald suit comme référent un jeune étudiant africain dans le cadre du collectif SAM. L’action du collectif repose sur l’entraide humaine autant que financière. Le couple de retraités apprécie de pouvoir échanger avec les personnes accueillies et privilégie ainsi le rapport humain. Au fil des accueils, le couple constate que la barrière des préjugés tombe : « accueillir des migrants, c’est aussi combattre ses propres préjugés sur les cultures différentes de la nôtre. Finalement, il n’y a pas de différences fondamentales entre les gens », confie Rosine.
Une édition spéciale sur Grand-Format
Pour prolonger cet article, découvrez les autres articles de notre édition spéciale sur la solidarité envers les migrants :
– « Les voir dormir dehors, ce n’était pas possible. » : une interview avec une sociologue et une bénévole, sur le mouvement de solidarité à Ouistreham.
– Solidarité : Granville en pince pour l’association Port d’Attache : un reportage à Granville lors d’une vente de homard au profit de l’association Port d’Attache, créée en 2011, qui vient en aide aux exilés échoués dans le pays granvillais.
A lire également, l’édition spéciale sur le racisme à Vire, construite avec des élèves du lycée Marie Curie et du collège du Val de Vire :
– Racisme, l’affaire de tous
De l’entraide naissent des relations parfois durables. « Les migrants souhaitent souvent rester à Vire car ils apprécient les petites villes, plus faciles pour se repérer », souligne une représentante d’un organisme qui aide les migrants. « Leur choix dépend aussi des rencontres qu’ils font sur place, notamment avec les membres des associations qui les soutiennent », complète-t-elle.
Gérald et Rosine ont beaucoup appris sur eux-mêmes de cette expérience. Vivre avec une personne inconnue dans la difficulté n’est pas une situation anodine. « Ce n’est pas la même chose de brandir une pancarte dans la rue et d’essayer de pratiquer l’humanité au quotidien », commentent-ils. Le couple n’a pas la sensation d’avoir transgressé les règles. « Quand bien même ça le serait, c’est avant tout une démarche humaine que nous avons eue », renchérit Gérald. « Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seconde », conclut-il. La solidarité passe avant tout par des gestes concrets.
*Les prénoms sont modifiés pour respecter l’anonymat demandé